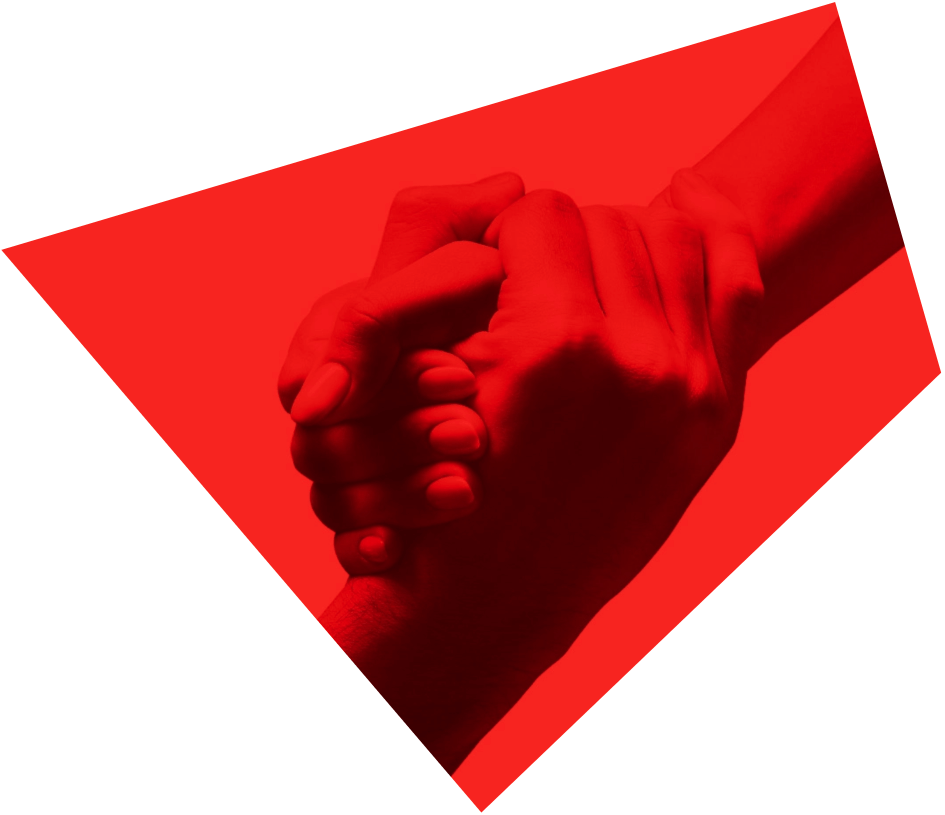LE MOIS DU PATRIMOINE asiatique est une occasion pour tous les Canadiens d’en apprendre davantage sur les réalisations et la contribution culturelle importante des Canadiens d’origine asiatique. Bien que ces réalisations méritent toute notre admiration, il devient encore plus important cette année de faire front avec nos collègues et amis canadiens d’origine asiatique en réponse à la montée de la discrimination à leur égard.
Le thème du Mois du patrimoine asiatique de cette année est « Reconnaissance, résilience et audace ». Ce thème incarne bien les sentiments éprouvés par les personnes d’ascendance asiatique au Canada. Aussi, le gouvernement fédéral souhaite profiter de ce mois pour rendre hommage à leurs contributions et à leurs histoires, qui sont des modèles de résilience et de persévérance.
Nous vous présentons ici les récits personnels, fascinants et éclairants de trois de nos collègues, des récits qui font réfléchir et nous permettent de mieux comprendre l’importance que revêt pour ces Canadiens d’origines asiatique le Mois du patrimoine. Plus que n’importe quel communiqué de presse ou discours d’entreprise, les histoires ont ce pouvoir de susciter l’empathie et de rapprocher les gens. Nous espérons que celles-ci amèneront les lecteurs à prendre au sérieux les questions liées au racisme, à l’inclusion et au respect de la vie personnelle et professionnelle.

Heon Lee, stagiaire
BIEN QU’IL SOIT important de reconnaître et de célébrer l’apport inestimable des Canadiens d’origine asiatique à la nation, le Mois du patrimoine asiatique de cette année va encore plus loin. Il nous invite à nous pencher sur des questions plus sensibles, à savoir les obstacles et les défis auxquels se heurtent les Canadiens d’origine asiatique.
« Nous partageons tous un héritage commun fait de diversités et de similitudes. Maintenant, pour changer les choses, il nous faut trouver des solutions et faire preuve de solidarité. »
Au cours de l’année écoulée, la montée de la haine, de la discrimination et de la violence envers les membres de la diaspora asiatique partout dans le monde s’est conjuguée aux effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19. Les personnes d’ascendance asiatique sont devenues des boucs émissaires, se sont senties menacées et ont été victimes d’actes de racisme flagrants. À Vancouver, ville reconnue pour la présence historique de Canadiens d’origine asiatique, les crimes haineux contre cette communauté ont augmenté de 717 % en un an seulement, selon un rapport de la police de Vancouver.
Bien que j’aie la chance de ne pas avoir été victime d’agressions comme beaucoup d’autres, les histoires que j’ai entendues et les expériences vécues par d’autres membres de ma communauté m’interpellent. Les questions liées à l’ethnicité, à la citoyenneté et à mon identité culturelle m’intéressent de plus en plus au quotidien. Du fait de vivre dans une nation multiculturelle, je suis soudain devenu plus conscient des choses que je tenais autrefois pour acquises.
Bien que les expériences de chaque Canadien d’origine asiatique au cours de cette pandémie aient été différentes, nous partageons tous un héritage commun fait de diversités et de similitudes. Maintenant, pour changer les choses, il nous faut trouver des solutions et faire preuve de solidarité.
Cette année, le Mois du patrimoine asiatique nous offre l’occasion de nous réunir pour discuter des mesures à prendre pour résoudre les problèmes qui nous touchent, ainsi que pour réfléchir au sens à donner à l’héritage asiatique au Canada.

Jamila Kanji, conseillère associée
DANS LE ANNÉES 1980, mes parents ont fait leurs valises et ont quitté l’Afrique de l’Est, laissant derrière eux leur maison, leur culture, leur famille et leurs amis. Ils sont arrivés au Canada avec quelques dollars en poche, mais beaucoup d’ambition, désireux de se construire une vie meilleure pour eux et leur future petite famille. Ils travaillaient le jour, étudiaient la nuit, s’habillaient dans les friperies et économisaient chaque dollar qu’ils pouvaient. Et déjà, ils avaient compris ce que veut dire « discrimination raciale ».
« Bien que le multiculturalisme soit un principe fondamental du Canada, les stéréotypes ont la vie dure et sont véhiculés pour nous définir d’une manière qui ne nous définit aucunement. »
Je suis fière d’avoir des parents qui ont immigré au Canada, qui ont tout risqué pour mes frères et moi-même, même si cela signifiait que nous devions arriver à l’aéroport plus tôt que les autres parce que nous serions contrôlés « aléatoirement » à la sécurité ; même si cela voulait dire éviter certains endroits sous peine qu’on nous lance un regard mauvais ou quelque chose de bien pire ; même si je savais que j’aurais à répéter une énième fois que je suis bien Canadienne et que je gagnerais moins d’argent qu’une femme issue de la majorité.
Notre histoire n’est pas exceptionnelle. Elle est celle de nombreuses autres personnes dévouées et travaillantes, qui ont tout abandonné pour entreprendre un nouveau voyage, qui ont choisi un pays plus sûr à une époque marquée par des bouleversements civils, sachant qu’elles seraient jugées en raison de leur accent, questionnées sur leur « vrai nom », et moins rémunérées que les autres dans des postes pour lesquels elles sont parfaitement qualifiées. Bien que le multiculturalisme soit un principe fondamental du Canada, le port du hijab et du turban ne cesse de faire l’objet de débats dans les provinces; les stéréotypes ont la vie dure et sont véhiculés pour nous définir d’une manière qui ne nous définit aucunement.
Y a-t-il des progrès ? Oui. Pouvons-nous faire mieux ? Absolument. J’ai espoir que les générations futures pourront fréquenter les écoles et travailler en sachant qu’elles sont tout aussi appréciées que leurs camarades appartenant à la majorité. Même si elles devront travailler dur, j’espère que les minorités seront bien représentées au cinéma, dans la littérature, dans les conseils d’administration des entreprises et partout ailleurs.
Le Mois du patrimoine asiatique nous donne l’occasion de réfléchir au travail qui a été accompli et à tout ce qui reste à faire. Plus encore, il nous permet de saluer le courage de ceux qui, comme mes parents, se sont aventurés dans l’inconnu avec rien d’autre que de l’espoir et des prières pour l’avenir.

Sabeen Thaver, conseillère
UN CONSEIL COURAMMENT donné aux nouveaux immigrants des pays asiatiques est le suivant : « Ne vous imaginez pas que vous obtiendrez un emploi de niveau comparable à celui que vous occupez actuellement. Pour trouver un emploi au Canada, vous devrez diminuer vos attentes ». Très souvent, parce qu’ils ne possèdent pas d’expérience au Canada, les nouveaux arrivants doivent accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Plusieurs entreprises hésitent encore à embaucher ces professionnels venus d’ailleurs, et ne semblent pas encore prêtes à composer avec les valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion.
Plus d’un Canadien sur cinq est né à l’étranger et environ six immigrants récents sur dix ont été admis au Canada à titre d’immigrants économiques. Il faut savoir que les immigrants économiques sont sélectionnés sur la base de leur parcours scolaire et professionnel exceptionnel. Ces immigrants choisissent le Canada parce qu’ils sont à la recherche d’un pays plus sûr qui offre des opportunités économiques.
Le Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC) est un groupe qui encourage les organisations à devenir plus inclusives et qui aide les nouveaux arrivants à s’épanouir professionnellement, notamment en les accompagnant dans le développement de leurs réseaux. Le TRIEC considère que deux facteurs sont essentiels à la réussite du parcours professionnel d’un immigrant : l’influence exercée par les cadres intermédiaires pour favoriser le sentiment d’inclusion et le rendement de l’immigrant; et la volonté de la haute direction qui établit la vision et la stratégie de l’organisation. Cette conclusion s’appuie sur des données probantes, ainsi que sur des entretiens avec des cadres intermédiaires et des responsables de la diversité et de l’inclusion, dont certains sont eux-mêmes des immigrants.
« Les organisations qui négligent de se doter d’une vraie stratégie de diversité et d’inclusion, exempte de préjugés et de discrimination, se retrouveront bientôt à la traîne. »
« Lors d’un entretien pour un emploi à salaire minimum, j’ai demandé à un responsable du recrutement s’il y avait un poste au sein de l’entreprise où je pourrais mettre à contribution mes compétences en marketing et en communication. Le gestionnaire m’a répondu que je n’avais pas d’expérience canadienne et qu’il fallait que je commence quelque part », a écrit un participant.
« Le conseil le plus fréquemment donné aux immigrants qui souhaitent progresser au sein d’une organisation est de faire preuve de gratitude. Je trouve que c’est un conseil intéressé : l’on ne devrait se sentir gêné de demander davantage, que ce soit en termes de salaire ou de responsabilités », a écrit un autre participant. Les séances de formation occasionnelles ne suffiront pas à défaire les préjugés. Il faut un engagement général et soutenu de la part de cadres intermédiaires qui sont favorables à l’intégration de la diversité. Le recrutement et la promotion de talents divers, ainsi que la promotion de la diversité des points de vue, sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte. De même, les dirigeants doivent accorder aux cadres intermédiaires les moyens nécessaires pour cerner les problèmes qui font obstacle à l’adoption de comportements inclusifs.
Une chose est sûre, le Canada a toutes les cartes en main pour agir. Les professionnels issus de l’immigration qui ont déjà une expérience internationale sont un atout certain et les gestionnaires ont tout à gagner à s’ouvrir à cette main-d’œuvre diversifiée. Les organisations qui négligent de se doter d’une vraie stratégie de diversité et d’inclusion, exempte de préjugés et de discrimination, se retrouveront bientôt à la traîne.