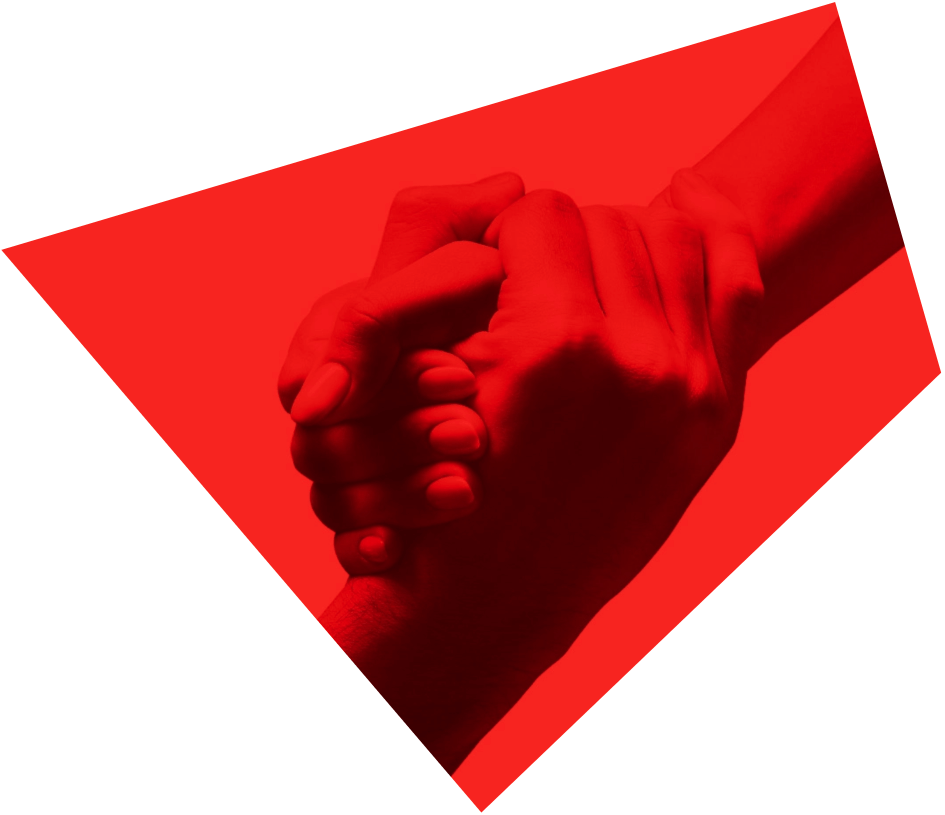C’EST LA SAISON du budget à Ottawa et les spéculations vont bon train sur le calendrier des prochaines élections fédérales et sur les engagements que prendra le gouvernement pour rebâtir notre économie. Dans les salons de la capitale nationale, prédire la date à laquelle les Canadiens iront aux urnes est devenu le passe-temps favori. D’ici le jour du budget, le 19 avril, on aura droit à des analyses quotidiennes approfondies des déclarations des chefs, on soupèsera l’effet de certaines mesures budgétaires appréhendées sur l’opinion publique et sur le résultat électoral dans des circonscriptions comme Nova-Ouest, Shefford ou Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill.
« Si la pandémie nous a fait prendre conscience de l’importance d’avoir un secteur public fort, elle a aussi montré que les gouvernements ne peuvent à eux seuls faire le travail. »
Si nous faisons abstraction de la course électorale pour un instant, il y a lieu de se demander en quoi la campagne budgétaire de cette année diffère de celles des années précédentes. La pandémie de COVID-19 a révélé des failles profondes dans la prestation des services sociaux et de santé les plus essentiels. Des industries entières ont été contraintes de se mettre à genoux. Et les gouvernements du monde entier ont dû reconnaître que les réponses politiques habituelles ne suffisent tout simplement pas pour relever les défis qui se présentent à nous. Si la pandémie nous a fait prendre conscience de l’importance d’avoir un secteur public fort, elle a aussi montré que les gouvernements ne peuvent à eux seuls faire le travail. Le Canada a surtout besoin que la reconstruction de son économie et la refonte de ses politiques publiques se fassent dans le cadre d’une approche globale de la société.
Dans son discours, le gouvernement fédéral semble vouloir procéder à des changements en profondeur dans un certain nombre de secteurs stratégiques. L’idée de rebâtir en mieux lui permet d’envisager de nouvelles approches sur les questions d’énergie et de changement climatique, par exemple, ou de soutien au revenu et à l’emploi, ou encore en matière d’infrastructure. Mais pour mener à bien ces transitions, il lui faudra établir des partenariats solides avec des entreprises qui profiteront également de l’occasion pour se transformer.
En fait, le gouvernement a déjà commencé à préciser ses attentes. Au cours de la dernière année seulement, il a lancé une nouvelle initiative, le Défi 50-30, afin d’accroître la diversité au sein des entreprises canadiennes. Il a également mis sur pied un nouveau Conseil d’action public-privé pour faciliter le financement durable au Canada. Le gouvernement a également demandé à la Banque canadienne d’infrastructure de collaborer avec le secteur privé afin de déployer des services à large bande en milieu rural et d’investir dans la production d’énergie propre. La question essentielle est de savoir si le gouvernement réussira à dénicher des partenaires.
Tout au long de la pandémie, de très nombreuses entreprises canadiennes ont démontré qu’elles étaient capables de relever le défi. Elles se sont adaptées à la situation et ont mis au point de nouveaux produits, fourni de nouveaux services et se sont réorganisées. Mais trop souvent, ces entreprises sont abandonnées par certains intervenants dont les demandes au gouvernement ne prennent pas en compte le fait que le monde a fondamentalement changé depuis ces 12 derniers mois. D’ailleurs, nombre de leurs exigences budgétaires pour 2021 ressemblent à celles du programme de productivité et de compétitivité du début des années 2000 ou du programme d’innovation du début des années 2010, mais présentées sous les oripeaux de la COVID-19.
Heureusement, un nombre croissant de chefs d’entreprise canadiens comprennent le changement qui est attendu de leur part. Ils savent que, pour établir un partenariat avec le gouvernement dans ce monde post-pandémique, ils doivent regarder plus loin que leurs rapports trimestriels et adopter une approche de gestion qui s’appuie sur une mission d’entreprise. Ils sont prêts à participer à la discussion et ont la volonté de s’adapter. Ces leaders souhaitent voir leur entreprise contribuer au bien-être de toutes les parties prenantes et considèrent l’équité, la diversité et l’inclusion comme des valeurs phares de leur développement. Tout aussi important, ils reconnaissent que le gouvernement actuel a la volonté politique d’apporter des changements systémiques d’envergure qui auront des répercussions dans divers secteurs. Ils savent aussi que ceux qui ne sont pas prêts à accepter ces changements risquent de se les voir imposer.
L’ancien Premier ministre Joe Clark rappelait souvent à ses conseillers que, lorsque l’on s’engage dans un débat portant sur une politique, il faut choisir entre marquer son point et apporter une réelle amélioration. Faire valoir son point donne à l’intervenant la possibilité de se concentrer sur les seuls besoins de son entreprise ou de son secteur, sans être gêné par des considérations extérieures. La demande est simple, mais elle laisse l’intervenant à l’écart de l’enjeu global. Le succès est possible, mais l’intervenant a moins de poids dans la décision.
Apporter une réelle contribution, en revanche, exige de l’intervenant qu’il formule sa participation en vue de résoudre le problème lié à la politique, et pas seulement en vue d’obtenir un avantage. Cela exige de l’ouverture et de la flexibilité, ainsi qu’un souci du bien public, pas seulement du gain privé. Ce sont précisément ces types d’intervenant qui deviennent des partenaires de confiance et d’influence. Et ce sont leurs initiatives qui ont le plus de chances d’être reconnues par la ministre Freeland dans son discours du 19 avril et par le gouvernement dans les mois et les années à venir.
Qu’elle se tienne au printemps ou à l’automne, la campagne électorale fédérale ne sera qu’une distraction passagère qui ne devrait pas détourner notre attention de la réflexion de fond et d’une vision à long terme qui s’imposent afin de nous relever de la pandémie. Au cours des prochains mois, la véritable affaire à surveiller sera le comportement de nos dirigeants du secteur public, qui devront démontrer du courage pour modifier leur approche en matière de politiques publiques, et ceux du secteur privé, qui devront faire preuve de créativité pour relever les défis qui s’annoncent.