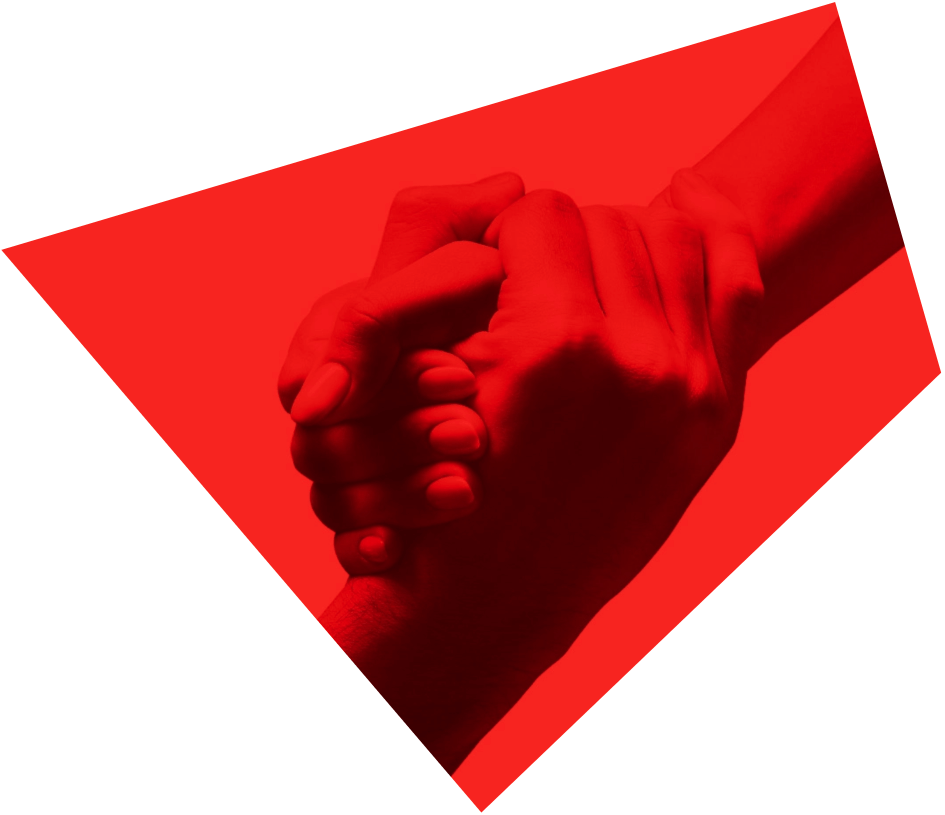Pour comprendre certains des enjeux auxquels font face les entreprises canadiennes, nous nous sommes entretenus avec Dominic Barton, l’un des plus fiers représentants du Canada à l’étranger et une autorité en matière de commerce international. Président de Rio Tinto et de LeapFrog Investments, M. Barton est également chancelier de l’Université de Waterloo. Il s’est récemment joint à l’Eurasia Group à titre de conseiller stratégique. Cet ancien ambassadeur du Canada en Chine a passé la majeure partie de sa carrière au sein de McKinsey & Company où il a occupé les fonctions de directeur général mondial.
Barton a accompagné certains des plus grands PDG de la planète dans des transformations difficiles et a conseillé des chefs de gouvernement au Canada, aux États-Unis, à Singapour et en Corée du Sud. Puisant dans cette expérience, Barton apporte un éclairage personnel sur le « nouveau modèle de mondialisation » qui se profile à l’horizon, sur la récession probable et sur les défis posés au mouvement ESG (environnement, société et gouvernance). Malgré la volatilité des conditions sociales et économiques, c’est avec optimisme qu’il entrevoit l’avenir des Canadiens et des entreprises au pays.
Au début de la pandémie de COVID-19, nous avons assisté à une montée du capitalisme participatif, ce qui a retenu l’attention des investisseurs et des médias. Alors que nous vivons une crise de l’abordabilité, le pendule est-il reparti dans l’autre direction ?
Nous arrivons à un point de bascule. On observe en ce moment une conjonction de plusieurs facteurs : les changements technologiques, les déplacements du pouvoir économique, les inégalités croissantes, le déclin de la confiance, les ruptures d’approvisionnement et la guerre en Ukraine. Les gouvernements et les entreprises s’inquiètent avec raison de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Un nouveau modèle de mondialisation est en train d’émerger.
Nous avons dépensé des sommes colossales pour endiguer les effets de la COVID-19. Et nous voici maintenant aux prises avec le spectre de l’inflation. On a l’impression que nos réservoirs sont vides et notre patience est à bout. Nous nous sentons fragiles et les gens sont frustrés.
À l’université, j’ai étudié les crises financières et économiques et, à l’instar de nombreux étudiants en économie, j’ai lu Manias, Panics and Crashes de Charles Kindleberger. Selon cet auteur, le cycle de vie d’une bulle financière se déroulerait en cinq phases. Lors de la quatrième phase, les initiés liquident leurs actions et, lors de la cinquième, c’est au tour des non-initiés de se retirer du marché, ce qui provoque l’éclatement de la bulle. Je pense que nous nous situons actuellement quelque part entre la quatrième et la cinquième phase. Après avoir atteint un pic en janvier 2022, qui nous donnait accès à des prêts bon marché et à des capitaux faciles à obtenir, la perte financière se chiffre aujourd’hui à près de 11 000 milliards de dollars en valeur boursière. Il s’ensuivra probablement une récession, des bouleversements et une hausse du chômage. Nous devons également être attentifs aux cycles politiques. On voit déjà les gouvernements tenter de maintenir un équilibre entre la défense des intérêts nationaux et ceux de la planète.
Je crois que le moment est venu pour les entreprises de se projeter dans l’avenir. Pendant que les gens s’affolent, voici peut-être l’occasion de bâtir quelque chose, d’optimiser ses avantages concurrentiels, ses talents et ses compétences essentielles, sans oublier la R.-D. et les fournisseurs, même si cela semble contre-intuitif à première vue.
Quel est ce nouveau modèle de mondialisation que vous entrevoyez ?
La mondialisation des échanges est là pour de bon. Nous ne mettrons pas subitement fin aux importations et aux exportations pour pratiquer le nationalisme économique. C’est une avenue que les consommateurs n’accepteront pas. Pas plus que les entreprises d’ailleurs, car ces dernières se sont adaptées à ce système qui a permis d’améliorer notre qualité de vie. La part des échanges commerciaux dans le PIB du Canada a augmenté de trois pour cent depuis la crise financière mondiale et le commerce mondial a presque triplé entre le début du siècle et l’année 2018. Mais nous avons de nouveaux défis à relever. On accorde aujourd’hui plus d’importance à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et des pays comme le Canada et les États-Unis favorisent la délocalisation entre pays amis. Cela fait que nous assisterons sans doute à une réduction du commerce des biens.
Les pays ont de bonnes raisons de vouloir sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement. Prenez l’exemple de l’Ukraine, qui produit la moitié du néon à l’échelle mondiale. Cette composante est essentielle au fonctionnement des lasers utilisés dans la fabrication des puces. Lorsque les deux principaux fournisseurs de néon ont été contraints de cesser leurs activités en raison de l’invasion russe, les répercussions sur la capacité mondiale de fabrication de puces et sur la production de téléphones cellulaires, d’ordinateurs portables et de voitures ont été immédiates. Il incombe aux pays de se pencher sur leurs vulnérabilités et de renforcer leurs capacités nationales dans certains secteurs.
Ensuite, nous observons des blocs commerciaux qui se consolident : la zone euro, l’Amérique du Nord (CUSMA), un bloc très important, et l’ASEAN (Asie du Sud-Est), qui représente plus de 600 millions de consommateurs. Il y a aussi le MENAP qui regroupe le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Pakistan, ainsi que le bloc formé par l’Afrique subsaharienne. On sait aussi que les liens entre les économies d’Amérique du Sud et d’Asie centrale se resserrent. À l’heure actuelle, 75 % de nos échanges commerciaux se concentrent en Amérique du Nord. Nous devons élargir nos horizons et évaluer la place qu’occupe le Canada dans chacun de ces blocs clés.
On conclut trop facilement au déclin de la mondialisation. Je crois plutôt que nous verrons l’émergence d’un autre type de mondialisation, que l’on pourra notamment observer dans les services commerciaux avec l’accroissement de la sous-traitance à l’étranger. Les informations continueront à circuler rapidement entre les frontières grâce aux plateformes comme Facebook, YouTube et TikTok. Déjà, les habitants du Royaume-Uni et de l’Indonésie sont très connectés dans les domaines du divertissement et du commerce électronique. Et à mon avis, ce n’est que la pointe de l’iceberg.
Nous avons vu la réaction des consommateurs et des dirigeants politiques canadiens face à l’invasion russe. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ?
La situation en Russie nous a montré les limites des échanges commerciaux internationaux. Les entreprises doivent envisager différents scénarios dans l’éventualité où le commerce et les investissements étaient interrompus. Que faire si on perd l’accès à une composante essentielle entrant dans la fabrication d’un produit dont nous avons besoin, par exemple une cellule photovoltaïque ou la puce d’un téléphone portable ?
C’est l’un des domaines où les organes de réglementation bancaire se distinguent : ils sont en mesure d’évaluer les risques. Et ils demandent aux banques de se préparer à ces risques extrêmes. Pensons au « risque associé à Taïwan », par exemple. Même si les possibilités de rupture sont faibles, il faut s’y préparer. Le risque n’est pas nul. C’est fou quand on pense qu’il y a dix ans, cette question ne nous aurait pas effleuré l’esprit.
Plusieurs dirigeants sont tenus de composer avec des objectifs à long terme tout en subissant d’intenses pressions pour réduire leurs coûts à court terme. Quels conseils leur donneriez-vous ?
Les entreprises sont dépendantes des cycles économiques et traversent parfois des périodes pénibles faites de hauts et de bas. Plusieurs d’entre elles peuvent faire faillite et disparaître. C’est un problème sérieux.
Plusieurs recherches ont démontré que, durant les grandes crises que le monde a traversées, que ce soit la crise financière mondiale de 2008-2009 ou la crise financière asiatique de 1997-1998, les entreprises qui ont investi et sont demeurées compétitives dans des domaines clés, comme la recherche et le développement, s’en sortent mieux et ont de meilleurs résultats financiers. Au cœur de la crise, le cours de leurs actions n’était probablement pas à la hauteur de celui de leurs concurrents, mais au bout du compte, leurs investissements stratégiques leur ont été profitables.
Au milieu de la crise financière asiatique, en Corée et à Singapour, la plupart des entreprises étrangères fermaient leurs portes, réduisaient leurs activités ou quittaient la région en disant : « C’est fichu, c’est la fin ».
Dans les années 1990, la société de conseil Booz Allen occupait la première place dans la région Asie. Qu’a-t-elle fait quand la crise asiatique a frappé ? Elle a réduit ses activités. Chez McKinsey, nous estimions que l’Asie demeurait un marché à fort potentiel malgré tous les défis qui se posaient. Nous souhaitions devenir un joueur important sur le continent, c’est pourquoi nous avons investi et recruté un grand nombre de professionnels, y compris ceux qui venaient de quitter Booz Allen. Aujourd’hui, McKinsey est le principal cabinet de conseil stratégique de la région.
Cela est un exemple parmi tant d’autres, mais en période de bouleversement, la haute direction doit être attentive au cycle que traverse son entreprise pour mieux discerner les occasions. Elle doit reconnaître que ce sera difficile et qu’elle devra l’exploiter de la manière la plus efficace et la moins chère possible. Mais aussi se convaincre que le fait d’investir dans des domaines prioritaires lui permettra de se retrouver à terme dans une situation plus favorable. Cela prend du cran. Cela exige de prendre un tournant stratégique et de croire qu’en mobilisant les énergies et en étant offensifs et disciplinés, l’on peut devancer la concurrence. N’est-ce pas ce que doivent faire les entreprises axées sur le long terme ? Warren Buffet l’a bien compris. Rappelez-vous son investissement de 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs en 2008…
Parallèlement, elle devra aussi se demander combien il y aura de postes à sacrifier. Pour ma part, je préférerais rencontrer les dirigeants pour les convaincre de réduire les dépenses. Oui, il faudra se serrer la ceinture, éliminer les primes, rogner sur tout ce qui n’est pas essentiel. Mais il faudra aussi éviter de toucher à ce qui est fondamental, notamment les ressources humaines, la R.-D. ainsi que les relations avec les clients et les fournisseurs privilégiés.
La polarisation des opinions politiques est-elle un obstacle pour le mouvement ESG ?
Depuis que je suis à Rio, j’ai observé un certain changement. Les investisseurs étaient très enthousiastes et intéressés par l’ESG et nos objectifs de décarbonisation. Cet engouement s’est quelque peu estompé depuis. Des gens m’ont même dit : « imaginez votre dividende si vous n’étiez pas sortis du secteur du charbon ».
J’ai expliqué que nous avons quitté de cette filière, car nous nous sommes engagés à effectuer un virage. Notre entreprise, qui a 150 ans, a un horizon d’investissement de 20 à 30 ans et notre réponse au problème climatique est la bonne. Nous mettons notre énergie à atteindre nos objectifs de décarbonisation. Des coûts à court terme sont à prévoir, mais nous nous plaçons en position de gagner la grande bataille. Je suis plus déterminé que jamais.
Nous constatons cependant que certaines mesures pro-ESG peuvent être source de conflits. Elles ne s’accordent pas toujours. Dans le cas de Rio, par exemple, nous souhaitions trouver une solution mutuellement bénéfique avec les dirigeants autochtones de l’Arizona dans le cadre de notre projet Resolution Copper. Le respect et la collaboration avec les communautés d’accueil sont essentiels.
Ce projet nous apparaît nécessaire, car les États-Unis et le monde entier ont besoin de cuivre. Sans cette matière première, nous ne pourrons pas réaliser la transition énergétique. Depuis que l’humanité existe, sept cents millions de tonnes de cuivre ont été produites. Pour atteindre les objectifs de Paris, nous devrons produire la même quantité, mais en 20 ans seulement. Le projet est justifiable d’un point de vue environnemental, mais son acceptation sociale nécessite un travail assidu.
Nous devons apprendre à accepter et à mettre en œuvre certaines solutions, même imparfaites, car autrement, rien ne se fera. La recherche de la perfection est parfois l’ennemi du bien. Nous ne pouvons rester assis et paralysés et laisser la planète se consumer. Cela serait inacceptable.
Dans cet ordre d’idées, quel est le rôle des sociétés minières dans la transition climatique ?
Leur rôle est indispensable. Nous ne pourrons pas décarboniser sans les minières. La fabrication d’une éolienne de 1,5 MW nécessite à elle seule 1 900 livres de cuivre, et il faut six fois plus de minéraux critiques pour fabriquer un véhicule électrique que pour construire une voiture ordinaire.
L’exploitation minière est donc essentielle, mais on peut faire mieux en matière d’acceptabilité sociale. Même les populations qui comprennent l’importance des mines n’en veulent pas dans leur cour. Les minéraux peuvent se trouver n’importe où, parfois dans les régions les plus reculées de la planète. Nous devons composer avec cet état de fait et nous engager avec les communautés d’accueil de manière responsable.
À Rio, notre objectif est d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Nous voulons réduire nos propres émissions de niveaux 1 et 2 de 50 % d’ici 2030, mais il importe de mieux expliquer notre travail, et les raisons pour lesquelles ce travail est utile pour la planète.
Nous venons de parler des défis que rencontrent les entreprises canadiennes. Qu’est-ce qui vous rend optimiste ?
Je considère que le Canada a un énorme potentiel, surtout en ce moment. Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes huit milliards d’habitants et nous serons bientôt dix milliards. Des forces sourdes sont en mouvement : la recherche technologique, le dérèglement climatique, la démographie, l’inégalité des revenus. Je ne connais pas de pays mieux placé que le Canada pour faire face à tout cela.
D’abord, nous disposons d’eau, d’énergie et de ressources minérales. Ensuite, nous avons une population dont les valeurs sont planétaires et multiculturelles. C’est un avantage énorme dans notre monde complexe.
Nous sommes un chef de file dans les technologies, mais nous n’en parlons pas. Pensons à Nortel ou à BlackBerry ou à l’intelligence artificielle, un secteur qui me passionne, car nous avons trois centres de classe mondiale au Canada et je pense que nous sommes également des leaders en la matière. Tous les éléments sont en place, mais je remarque que nous manquons parfois d’ambition.
Sans rien tenir pour acquis, nous observons que la polarisation politique est bien moins prononcée ici qu’aux États-Unis. Nous sommes une nation raisonnable. À long terme, cela a son importance. Nos fonds de retraite sont remarquables et de calibre mondial. J’aimerais bien voir tout le potentiel canadien se déployer.
Je rêve de voir le Canada abriter une cinquantaine de grandes entreprises mondiales occupant les tout premiers rangs dans leur secteur d’activité. Cela nous permettrait de créer notre propre réseau d’excellence grâce à la R.-D., à l’innovation et au développement du leadership et des talents. Peut-être qu’en raison de nos forces, nous sommes devenus un peu trop complaisants. Mais je demeure tout de même persuadé que notre pays ira loin.
*Le contenu de cet entretien a été modifié pour des raisons de longueur et de clarté.