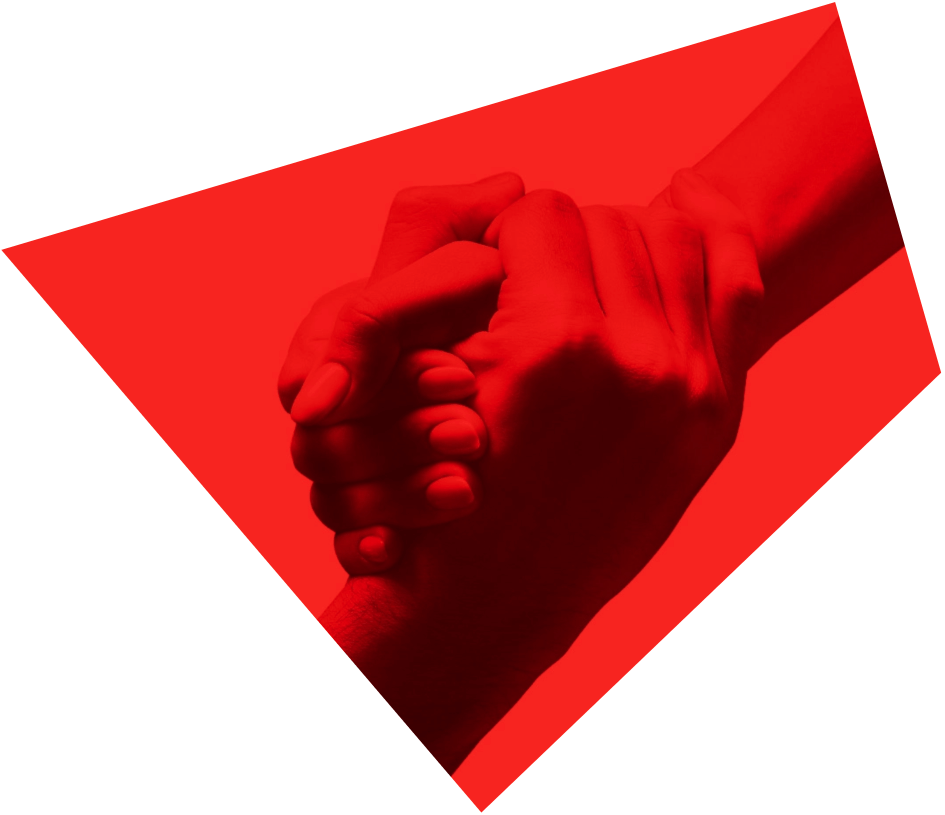Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, l’ascension de Pierre Poilievre au poste de chef du Parti conservateur est l’illustration d’un réalignement majeur de la politique canadienne. M. Poilievre a remporté une victoire écrasante grâce à une plateforme prônant un retour aux libertés individuelles, une résistance à la rectitude politique ambiante et un désir d’agir concrètement pour rendre la vie plus abordable.
M. Poilievre ne mise pas seulement sur l’appui du col bleu masculin traditionnel, mais sur celui de la classe ouvrière canadienne dans son ensemble, dont plusieurs membres ont subi les contrecoups de la pandémie. Contrairement à son rival, le premier ministre Justin Trudeau, M. Poilievre cherchera à canaliser la colère et le sentiment d’impuissance qui animent de nombreux Canadiens face à des phénomènes sur lesquels ils ont peu ou pas d’emprise, qu’il s’agisse d’inflation, de virus ou d’ouragans.
Voici ce qu’il faut savoir sur le mouvement qui a mené Poilievre à la victoire, et ce que cela révèle sur l’état de l’opinion publique canadienne, d’un bout à l’autre du pays.
Colombie-Britannique
Par Alex Shiff
Directeur associé
Des gains dans le Grand Vancouver et le Lower Mainland pourraient bien assurer la victoire des conservateurs en Colombie-Britannique. Pierre Poilievre et son équipe en sont bien conscients, et c’est pourquoi ils y ont passé beaucoup de temps durant la campagne à la chefferie. Poilievre a réussi à attirer des foules de sympathisants, galvanisés par son style bien à lui.
Avec son message particulièrement bien adapté aux réalités des électeurs de ces circonscriptions, le chef conservateur pourrait bien conquérir les banlieues de la province. Ses positions sur le logement et le coût de la vie plaisent aux millénariaux, qui ont vu leur niveau de vie décliner sous le gouvernement Trudeau en raison de l’augmentation des coûts. Le parcours personnel de Poilievre et la place qu’il accorde dans son discours à la libre entreprise, à la liberté d’expression et à la religion lui attirent également les faveurs des communautés d’immigrants, fortement représentées dans les banlieues.
Le chef Poilievre passera sans doute beaucoup de son temps à faire campagne dans la région métropolitaine de Vancouver et à peaufiner ses messages en vue de rallier les électeurs de banlieue, une des clés pour accéder au 24 Sussex.
Alberta
Par Lauren Armstrong
Conseillère principale
La crise du logement et l’inflation se profilent à l’horizon et l’abordabilité du logement dans les grandes villes est un sujet de préoccupation pour les Albertains. Dans l’esprit du nouveau chef du Parti conservateur fédéral, l’Alberta demeurera toujours le cœur du pays, son port d’attache et l’endroit où il peut récolter des centaines de milliers de votes et des dizaines de millions de dollars. Mais pour conserver sa popularité et séduire les donateurs albertains, M. Poilievre, lui-même originaire de Calgary, devra éviter d’aborder les questions sociales délicates. Il devra plutôt tenter de faire des gains sur des sujets concrets qui ont une incidence sur le portefeuille.
Il lui faudra aussi se livrer à un jeu d’équilibriste : s’opposer aux politiques de Trudeau, particulièrement celles perçues comme nuisant aux travailleurs, sans mettre en péril les domaines de coopération entre les entreprises et les gouvernements provincial et fédéral, comme la capture et le stockage du carbone. La stratégie qu’adoptera Poilievre sera la même que celle employée par les premiers ministres de l’Alberta depuis des décennies : se montrer dur en public et négocier habilement derrière les portes closes.
Saskatchewan
Par Jim Billington
Directeur associé
Avec ses 14 circonscriptions électorales actuellement représentées par des députés conservateurs, la Saskatchewan revendique le titre de province la plus conservatrice du Canada. M. Poilievre et son parti continueront probablement à faire la loi dans la province, laquelle exprime un profond dédain pour M. Trudeau et son gouvernement libéral.
M. Poilievre s’opposera à certains éléments clés du programme environnemental de M. Trudeau, comme l’ont fait avec succès les chefs conservateurs précédents. Cependant, un défi plus large l’attend, soit celui de répondre aux principales préoccupations de ses nombreux partisans de la Saskatchewan, une tâche à laquelle ses deux prédécesseurs ont failli.
En Saskatchewan, le désaveu à l’égard de la politique du gouvernement Trudeau alimente un désir d’autonomie provinciale, ce qui n’a pas échappé au premier ministre Scott Moe. Dans sa quête de pouvoirs accrus et à l’instar du Québec, la Saskatchewan peut compter sur un allié en la personne de Poilievre. Il reviendra donc au nouveau chef conservateur de trouver l’équilibre entre les demandes de l’Ouest et les priorités des électeurs des autres régions du Canada, qui pourraient n’éprouver que peu d’intérêt pour les revendications autonomistes des Prairies.
Québec
Par Philippe Gervais
Directeur principal
Au Québec, nous avons assisté à un réalignement politique comme on n’en a pas vu depuis des lustres. Il y a quatre ans, la Coalition Avenir du Québec (CAQ) de M. Legault avait été élue pour la première fois dans la province. Du coup, la jeune formation avait écarté du pouvoir les deux grands partis qui dominaient la scène politique depuis la fin des années 1960. Le 3 octobre dernier, la CAQ confortait sa position en remportant une victoire encore plus éclatante, ne laissant que des miettes à ses adversaires et un trou au centre de la carte électorale correspondant à l’île de Montréal. Comment expliquer ce raz-de-marée ?
Il ne fait aucun doute qu’un nombre croissant d’électeurs québécois sont mécontents et ne se retrouvent plus dans les partis politiques traditionnels. Même M. Poilievre a profité de ce ressentiment et de l’insatisfaction à l’égard du statu quo, comme en témoigne sa victoire sans équivoque contre Jean Charest, pourtant considéré comme « l’élu » par de nombreux conservateurs québécois de longue date.
Avec ses messages axés sur la défense du « Nous » québécois, M. Legault a fait ressortir la division de l’électorat : les électeurs n’hésitent plus à clamer leur identité régionale et rejettent l’ingérence du gouvernement fédéral. Voilà l’occasion toute trouvée pour Poilievre d’intensifier sa critique de la gestion interventionniste d’Ottawa sans rompre avec les principes fondateurs du Parti conservateur du Canada.
Les entreprises nationales et internationales doivent prendre acte de ce réalignement en s’engageant à respecter l’identité et la culture uniques des Québécois. Celles qui n’y parviennent pas risquent de se voir rejetées, tout comme l’a été la « vieille garde » politique québécoise.
Ontario
Par Clare Michaels
Directrice associée
M. Poilievre aurait tout à gagner de s’inspirer des succès du populiste Doug Ford. Si tel est le cas, un parti dirigé par Poilievre prêterait moins l’oreille aux préoccupations des grands employeurs et s’intéresserait davantage à l’opinion de leurs employés.
Le gouvernement Ford a reconnu la nécessité de mettre le conservatisme fiscal en veilleuse afin de s’attaquer aux grands problèmes systémiques, en particulier ceux qui touchent la classe ouvrière ontarienne. Dans cette liste qui ne cesse de s’allonger figurent l’inflation, l’accès aux soins de santé et la mise en place de réseaux de transport collectif et d’autoroutes pour lutter contre les embouteillages.
Les victoires de Doug Ford en 2018 et 2022 sont attribuables en grande partie à l’effort déployé pour courtiser les personnes les plus durement touchées par ces problèmes, dont les ennemis traditionnels des conservateurs que sont les travailleurs syndiqués. Non seulement un nombre impressionnant de syndicats l’ont appuyé, mais Ford a également démontré son habileté à contourner les chefs syndicaux pour rejoindre directement leurs membres, en véhiculant des idées pragmatiques, aussi bien sur les lieux de travail qu’à l’extérieur.
Nous avons été témoins sous son règne d’un réalignement majeur de la politique syndicale. Les orthodoxies et les mentalités habituelles n’ont plus autant la cote. Les chefs d’entreprises canadiennes pourraient profiter de cet assouplissement pour faire des gains, en proposant aux syndicats de nouvelles politiques et initiatives susceptibles de créer de la croissance et des emplois de qualité.
Atlantique
Par Jason Hatcher
Directeur principal
Les provinces de l’Atlantique sont souvent les grandes oubliées des stratégies politiques fédérales, étant donné qu’elles ne détiennent qu’une fraction des sièges au Parlement. Rappelons-nous qu’en 2015, Justin Trudeau y avait raflé la totalité des 32 sièges. Lors des dernières élections, le Parti conservateur du Canada a tenté d’y retrouver des appuis, mais sa récolte s’est limitée à huit sièges.
La vague conservatrice qui a déferlé au Canada, alimentée par les mouvements anticonfinement et libertariens (et par conséquent pro-Poilievre) n’a eu que peu d’effet sur l’humeur sociale de la région. Le profil culturel des habitants des Maritimes est unique. Étant donné qu’il n’y a eu que peu de mesures de confinement sévères dans la bulle atlantique, la polarisation des électeurs est nettement moins marquée que dans d’autres régions du pays.
En matière économique, l’énergie demeure une question brûlante pour la majorité des électeurs. Pour s’attirer leur faveur, M. Poilievre devra présenter une politique énergétique plus inclusive et miser sur la collaboration et les alliances entre l’Est et l’Ouest du pays, un peu comme ce fut le cas au début des années 1980. Sa politique d’ouverture économique ne suffira pas à reconquérir les Maritimes. Il doit présenter des opportunités concrètes à la population qui se sent trop souvent délaissée par le gouvernement fédéral.