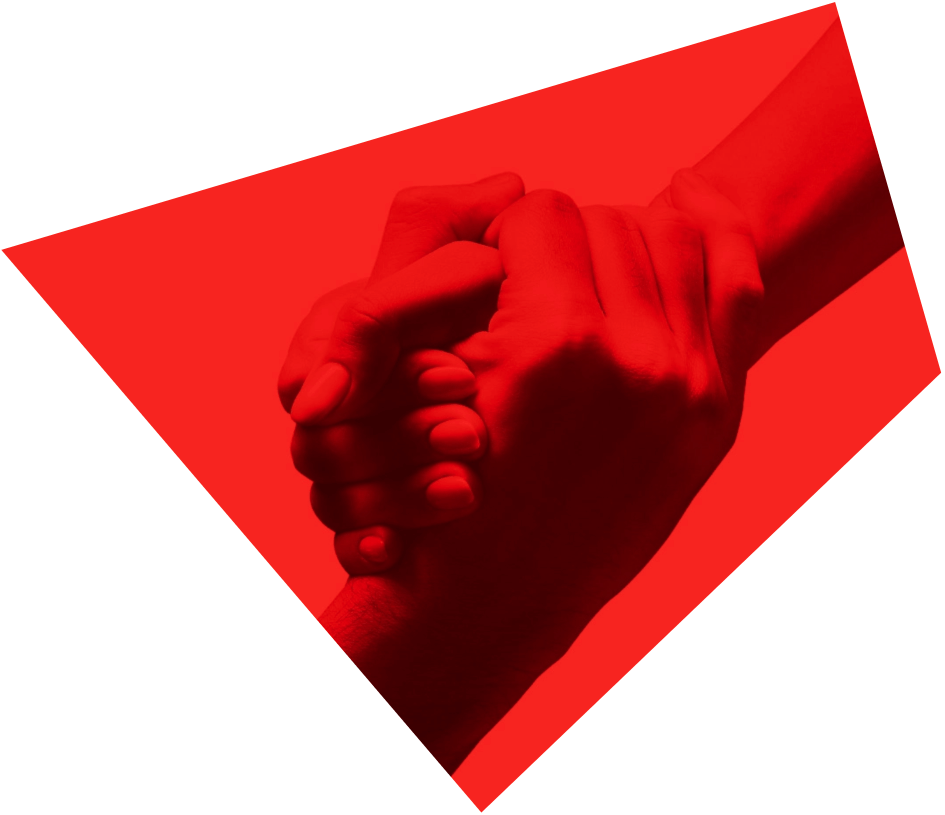DEPUIS DES DÉCENNIES, on fait appel aux méthodes, à la pensée créative et à la réflexion stratégique des designers du monde entier pour nous aider à résoudre les grands problèmes de société. Grâce aux talents des designers, l’ensemble de la société peut jouir de produits, de services et de systèmes durables, qui sont inclusifs et respectueux des différents besoins et cultures. Aujourd’hui, avec la pandémie de COVID-19 qui a révélé de profondes inégalités sociales, il y a lieu de réfléchir au monde que nous voulons construire demain. L’apport du design sera essentiel.
La crise actuelle a exposé au grand jour nos failles sur le plan humain et aucune facette de notre société n’a été épargnée. On a découvert la précarité dans laquelle vivent trop de nos concitoyens, et le rôle vital que jouent nos travailleurs de première ligne, dont on avait sous-estimé la contribution. Dans le milieu des affaires, on s’intéresse désormais aux questions sociétales, on revoit la mission d’entreprise et on est prêt à assumer un rôle accru pour relever les défis de l’heure. Dans les secteurs public et privé, le temps est venu de mettre à l’œuvre la créativité des designers et de les inviter à réfléchir aux grandes questions, en concertation avec les communautés.
« Dans le meilleur des cas, le design se concentre sur les besoins des utilisateurs et engage ces derniers dans la définition des problèmes et l’expérimentation de solutions. »
Le design est une pratique intentionnelle, créative et technique qui consiste à trouver des solutions pratiques à des besoins humains. C’est une démarche qui prend en considération les parties prenantes et s’appuie sur une vision d’avenir, en ce sens qu’elle tente non seulement de répondre aux besoins et usages d’aujourd’hui, mais aussi à ceux de demain. Dans le meilleur des cas, le design se concentre sur les besoins des utilisateurs et engage ces derniers dans la définition des problèmes et l’expérimentation de solutions. Fondamentalement, le design est lié à la mission de l’organisation, les deux découlant de décisions ayant des incidences plus larges sur les communautés et les individus.
Les designers issus des communautés noires, autochtones ou racialisées apportent leur expérience de vie et leur sensibilité à la création de designs inclusifs et porteurs de sens pour les entreprises, les consommateurs et les communautés. Afin d’encourager l’enseignement et la recherche sur le design inclusif, l’université OCAD a embauché cinq professeurs issus de la communauté noire en 2020 sous la direction de la doyenne Dori Tunstall, la première doyenne noire au monde dans le domaine du design. L’université s’est également donné des moyens d’améliorer son approche en matière de design autochtone. Cette année, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, la prestigieuse College Art Association et le Advertising and Design Club of Canada (ADCC) explorent les contributions et les approches des designers afro-descendants.
Les projets de design qui répondent à des problématiques d’aujourd’hui abondent. Récemment, les dirigeants de l’Union européenne ont adopté « le nouveau Bauhaus européen », une initiative qui vise à encourager les designers à mettre leur art au service d’une Europe post- COVID plus égalitaire, plus résiliente et plus écologique. Ce mouvement milite pour un design durable et pour un équilibre entre fonction et esthétisme. Il appelle à une collaboration entre les entrepreneurs et les créateurs afin de lutter contre les changements climatiques, par exemple en imaginant des solutions à grande échelle dans les domaines du bâtiment, du transport ou de l’innovation numérique peu énergivore.
D’autres exemples existent. Plusieurs mouvements tel le nouveau Bauhaus s’inspirent des 24 Principles for Designing Massive Change de Bruce Mau, qui invitent à la générosité, à l’inclusion sociale et à faire preuve de sensibilité écologique. Les travaux de Mau insistent sur la valeur transformatrice d’un design sensible, en tant qu’outil pour améliorer la qualité de vie et relever les grands défis.
Concrètement, dans l’après COVID, on ne pourra plus ignorer l’importance de revoir nos espaces physiques. Nous ne pourrons tout simplement pas laisser le « business as usual » prévaloir. C’est en raisonnant selon cette logique du statu quo que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd’hui. Il faudra plutôt faire preuve d’audace et se montrer prêt à revoir notre utilisation de l’espace et la façon dont nous le partageons.
Le design peut aider les entreprises qui repensent leur mission et se préparent à évoluer dans un nouveau contexte. Le processus de « design thinking » et la boîte à outils du designer ont fait leurs preuves. Durant cette démarche créative – à laquelle participe une variété d’intervenants et de sources – on détermine les besoins, on définit et résout les problèmes. Dans l’idéal, on privilégie des remue-méninges réunissant des participants de tous les niveaux de l’organisation, parfois même de l’extérieur, pour profiter d’une diversité d’expériences et d’un regard pluridisciplinaire. Ces contributions sont essentielles pour entreprendre avec sérieux un changement de mission.
En recourant à une variété de techniques, allant de l’observation et de la collecte de données à l’esquisse et au brainstorming, les participants du « design thinking » cernent les enjeux et les opportunités, puis se lancent dans l’élaboration de stratégies. Ils créent des concepts qui sont aussitôt évalués, éliminés ou améliorés, selon les commentaires des parties prenantes. L’objectif est l’amélioration continue dans un contexte en évolution. Une approche inclusive et généreuse du design fait partie intégrante du processus. On s’assure aussi de tenir compte des besoins et de l’opinion des divers individus et groupes en présence pour déterminer les besoins, les questions, les objectifs et les résultats.
La méthode du « design thinking » s’applique facilement aux innovations techniques. Mais elle est tout aussi viable dans le domaine de l’innovation organisationnelle. La méthode aide les groupes à se poser les bonnes questions compte tenu du contexte et des enjeux en présence. Elle encourage les participants à faire preuve d’empathie, c’est-à-dire à imaginer des situations à partir de regards différents. Elle peut même déboucher sur des solutions permettant de réduire les disparités économiques ou donner accès à de nouveaux bassins de candidats ou à de nouveaux marchés.
Le « design thinking » a été utilisé avec une grande efficacité dans le secteur privé. IBM l’a notamment employé dans le cadre d’une refonte radicale de sa stratégie de services et de fourniture de systèmes s’appuyant sur l’intelligence artificielle. La démarche lui a permis d’améliorer le rendement de son investissement. La Clinique Mayo, quant à elle, applique la méthode du « design thinking » afin de mieux comprendre l’expérience des patients avec les soins de santé. On analyse en profondeur l’expérience des bénéficiaires, puis on réunit médecins et designers pour discuter de l’approche des soins. Enfin, on crée puis on déploie un prototype de parcours de soins dynamique centré sur le patient.
Alors que notre monde se transforme et que nous tentons d’entrevoir le rôle qu’y jouera le secteur privé, les chefs d’entreprises et les décideurs politiques sont invités à se tourner vers le design et la méthode du « design thinking ». La pandémie a rappelé aux entreprises et à des pans entiers de l’économie la nécessité d’user de stratégies créatives pour gérer la crise et innover dans l’après COVID. Le design et ses outils permettent justement de stimuler la créativité et l’innovation, et ne peuvent que contribuer à enrichir notre réflexion sur la société.