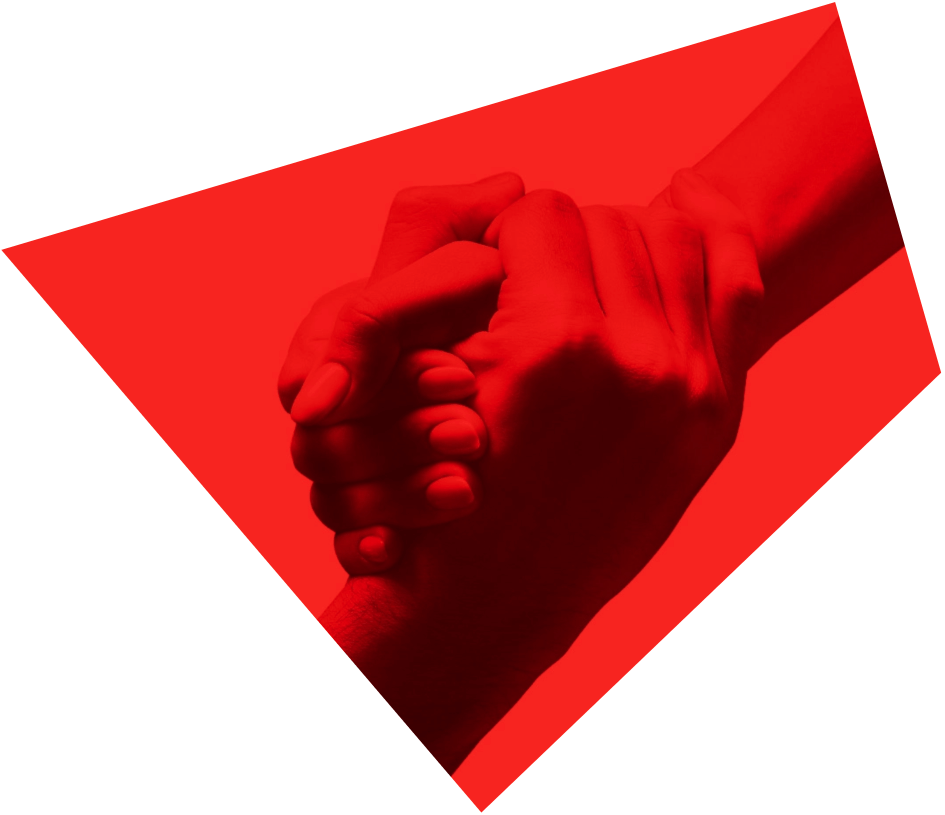« L’ÉCHEC DES SONDAGES montre que la citoyenneté a gagné et que les Américains ont su s’affranchir des enquêtes d’opinion. » Cette phrase n’a pas été prononcée dans la foulée de l’élection présidentielle de 2020, mais il y a plus de soixante-dix ans. Lors de l’élection de 1948, les sondages inspiraient confiance à un point tel que la presse n’hésita pas à annoncer la victoire de Thomas E. Dewey sur Harry Truman. « Un sondeur déclare que les jeux sont faits » et « Dewey donné largement victorieux en novembre », lisait-on en manchettes.
Seulement, voilà : à la grande surprise des sondeurs et des oracles en tous genres, Truman fut réélu. À peine née, la profession fut la cible de critiques acerbes et de quolibets bien mérités (le terme anglais pollster – « sondeur » – date de cette époque; on le doit à Lindsay Rogers, qui s’inspirait du roman dans lequel Frederic Wakeman s’en prenait aux publicitaires modernes – The Hucksters, ou « Marchands d’illusions »). George Gallup dut même aller témoigner devant le Congrès.
À la suite de l’élection présidentielle américaine de 2020, les commentateurs politiques ont également prédit la fin des firmes de sondage. Comme quoi l’histoire se répète… Les Canadiens pourraient se contenter d’un haussement d’épaules, en expliquant le revers des sondeurs par la singularité des États-Unis. Une autre réaction consisterait à espérer que les choses « finissent par passer » comme le dit un vieux proverbe perse : Mais nous pouvons aussi tirer des leçons du passé, accepter les faits et saisir l’occasion de nous améliorer.
« Si elle veut ouvrir un nouveau chapitre, la profession doit commencer par réaffirmer qu’une enquête d’opinion ne se limite pas à faire des sondages. »
En 1948, le geste le plus remarquable des sondeurs a été d’éviter le déni et de regarder les résultats en face. Plutôt que d’essayer de trouver des excuses, les pionniers (George Gallup, Elmo Roper et Archibald Crossley) ont admis le dérapage et promis de faire mieux. Ils sont revenus aux principes fondateurs des enquêtes d’opinion et ont choisi d’emprunter des voies plus prometteuses. Abandonnant les sondages par quotas, ils se sont tournés vers l’échantillonnage probabiliste. Aussi, ils ont compris qu’il fallait sonder les électeurs jusqu’au jour du scrutin. Que nous disent les choix qu’ils ont faits alors sur l’avenir de la profession?
On critique souvent les sondeurs, mais les grandes entreprises, les médias, les groupes d’intérêt et les acteurs politiques comptent sur leurs lumières et leurs analyses stratégiques. La résilience de la profession tient entre autres à sa capacité d’innover sans cesse. Dans les années 1980, les interviews téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO) ont eu un impact majeur – grâce à l’informatique, les choses devenaient plus faciles. Quand les changements de style de vie ont rendu cette approche compliquée, les sondeurs se sont tournés vers les groupes de discussion en ligne et de nouvelles manières de conduire les entretiens en ont découlé.
Aujourd’hui, les capacités illimitées de stockage et de traitement associées aux mégadonnées (big data) ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’analyse. Nous ne faisons que commencer à saisir les possibilités qu’offrent les plateformes de gestion de données, les communautés en ligne interreliées par API et la surveillance des médias sociaux.
Si elle veut ouvrir un nouveau chapitre, la profession doit commencer par réaffirmer qu’une enquête d’opinion ne se limite pas à faire des sondages. Elle consiste à combiner des informations tirées de nombreuses méthodologies – quantitatives, qualitatives ou indirectes –pour transformer des données informes en un tableau vivant des opinions que nourrit tel ou tel groupe à propos d’un enjeu, d’une entreprise, d’un candidat ou d’un produit. Les études qualitatives, pour ne parler que d’elles, sont de plus en plus intégrées aux plans de recherche; elles révèlent des nuances et des particularités qui échappent aux autres méthodes. Disposant du portrait parlant et directement exploitable que la combinaison voulue d’outils de recherche permet de dresser, une entreprise ou un intervenant individuel peut non seulement exercer une certaine action, mais influer réellement sur les changements en cours.
Une enquête d’opinion est davantage faite pour expliquer pourquoi les gens pensent de telle façon que pour dresser des pronostics. Trop souvent, les sondeurs ne choisissent pas la bonne cible. Comme le disait Allan Gregg, ils cherchent surtout à compter les voix – dénombrant les opinions exprimées au lieu d’analyser ce qui se cache derrière et ce que ressentent les intéressés. La lumière commence à se faire quand on ne se contente plus de quantifier mais que l’on essaie de déchiffrer comment se forment les opinions.
Les pionniers n’avaient aucune idée de ce que les outils technologiques nous permettent de faire. Aujourd’hui, on parle sans arrêt de mégadonnées. C’est un peu par effet de mode, mais il n’en est pas moins vrai que l’« analytique des données massives » pourrait bien révolutionner les enquêtes d’opinion. Particulièrement intéressants sont les outils comme les plateformes de gestion de données (DMP, pour Data Management Platform), qui permettent de suivre l’activité des utilisateurs d’appareils numériques.
Une plateforme DMP est un référentiel dans lequel sont consignées des données provenant de différentes sources en ligne ou hors ligne. Il permet de définir des segments granulaires fondés sur le comportement des utilisateurs. Les données relatives à leurs champs d’intérêt, à leur profil sociodémographique, à leur lieu de résidence et à leurs habitudes (d’achat, notamment) permettent d’établir des profils individuels. La plateforme repose sur l’information générée à partir de ce qu’on appelle, de manière générale, les « mouchards » (cookies). C’est ce qui permet d’avoir une connaissance détaillée des utilisateurs.
Dès lors, l’étude de l’opinion prend une nouvelle forme. Les enquêteurs peuvent en savoir beaucoup sur les intéressés sans même leur poser de questions. Une plateforme DMP permet de savoir quels sites Web un consommateur a consultés avant d’acheter tel produit, où se déplace telle personne (son appareil mobile nous l’apprend), de quel parti politique tel électeur consulte le site, etc. Quand vous voyez apparaître à l’écran une annonce publicitaire concernant votre hôtel, votre magasin ou votre produit préféré, dites-vous que cette technologie est à l’œuvre en coulisses. Il va de soi qu’un outil qui sait déterminer vos goûts peut servir à mener des enquêtes d’opinion.
C’est un fait : les enquêtes d’opinion sont scrutées à la loupe. Les erreurs de parcours font évidemment les manchettes, mais l’étude de l’opinion continue de jouer un rôle essentiel – elle oriente les décisions des grandes sociétés, des groupes d’intérêt et des milieux politiques. Ce qui change, ce sont les méthodes. De plus en plus, les enquêteurs devront utiliser des techniques mixtes, incorporer des sources de données variées et tirer parti des derniers progrès technologiques. L’objectif reste le même : à l’aide des outils de pointe disponibles, dégager le sens des opinions individuelles – forcément diverses et parfois confuses.